Réaction 2 aux réalités de la salsa par un musicien
La vérité peut être occultée, mais pas détruite en réponse à l’ article :
REALITES SUR LA SALSA AFRO CUBAINE A NEW YORK :
Lire aussi Article réponse par les lecteurs à lire absolument !!!
Lire aussi Article de réaction composé par JM Olivares danseur passionné.
Tout d’abord, félicitations pour ce que ce site apporte à notre petite communauté de salseros parisiens. En tant que danseur (médiocre) et chanteur (moins médiocre), je voudrais moi aussi réagir à l’article du mois, et y apporter, autant que possible, quelques précisions.
Tout d’abord, sur Cuba en tant que « plaque tournante » maritime de la musique afro-américaine, même si c’est totalement vrai pour le 18e siècle et le tout début du 19e, on ne peut pas passer sous silence l’importance de l’industrie musicale (états-unienne et blanche, il est vrai) pour prendre le relai et assurer le rayonnement des rythmes afro-cubains, et cela dès les années 20-30. C’est d’ailleurs peut-être de là que datent certaines simplifications, mais c’est aussi cette industrie qui a permis, par exemple, au son montuno d’arriver jusqu’à Puerto Rico ou bien le succès phénoménal du boléro et du mambo au Mexique, qui ont ensuite vécus leur vie propre, coupée de Cuba.
A propos de la clave, on peut effectivement constater que certains instruments africains remplissent la même fonction, mais il faut, là aussi, rendre à Cuba ce qui appartient à Cuba, puisque c’est dans l’île que le rythme de la clave est passé du ternaire qui caractérise les musiques africaines au binaire de la musique cubaine. Ce phénomène de binarisation (ou créolisation) de la clave a été étudié dans un long et intéressant essai de Fernando Ortiz, l’ethnomusicologue qui a posé les fondations de l’étude scientifique de la musique afro-cubaine. Mais la clave (l’instrument) sous la forme qu’on connaît actuellement, découle
directement des chevilles utilisées par les ouvriers des chantiers navals pour assembler les grosses poutres de bois qui servaient à la construction des bateaux, et peut donc être effectivement considéré comme ayant vu le jour dans les ports de La Havane.
Sur l’importance quasi-nulle de l’apport indien dans la musique cubaine, nous sommes d’accord, c’est d’ailleurs la raison qui a poussé Fernando Ortiz a préférer le terme afro-cubain à celui, impropre, de indo-cubain ou indo-africain. Et si les maracas sont bien présentes dans la musique indienne, ils sont constitué d’une grosse calebasse sans manche, tenue à deux mains ; rien à voir, donc, avec la fabrication des maracas cubaines, qui découle directement d’instruments africains parfaitement connus et identifiés.
Sur les instruments afro-cubains, il est d’ailleurs intéressant de constater que les trois percussions principales de la salsa d’aujourd’hui sont issus de trois cultures différentes. Si les tumbadoras (ou congas) sont une adaptation d’instruments africains sans grands changements, les timbales (ou pailas criollas) sont un détournement des timbales des orchestres symphoniques ou des fanfares militaires européennes. Le bongo, lui, contrairement à une idée couramment répandue, est une création purement cubaine, puisqu’on n’en trouve pas d’équivalent, ni dans la fabrication ni dans la fonction, dans les musiques africaines. Cette trilogie étrange est, à mon sens, une des grandes richesses de la musique cubaine, qui réunit donc l’Europe, l’Afrique et le creuset cubain dans lequel les deux se sont fondus et mélangés. On peut faire d’autres analogies, en situant géographiquement le bongo dans les campagnes et plus globalement dans la musique paysanne de Cuba (son, guajira, etc.), les tumbadoras dans les faubourgs ouvriers (rumba, conga, etc.) et les timbales dans les villes et la musique de salon (danzon, cha cha cha, etc.). Ce qui fait, à mes yeux, l’une des raisons principales de l’universalité de cette musique, aux frontières de plusieurs mondes, géographiques, sociaux, culturels.
Enfin, quant aux prétendu manque d’innovation de la salsa nuyoricaine, il faut un peu remettre certaines choses au point. Musicalement et rythmiquement, il n’y a peut-être pas de différence fondamentale entre ce qui se jouait avant à Cuba et ce qui a vu le jour à New York. Mais la véritable différence, l’apport principal de la salsa (au sens étroit de « musique nuyoricaine des 70’s »), c’est au niveau du son et de l’orchestration. Tout d’abord, là où les Cubains utilisaient une ou plusieurs trompettes, les musiciens new yorkais ont introduit le son grave et sale du trombone en section. Cela n’a l’air de rien, mais c’est un élément important du son du barrio et du Spanish Harlem. Ensuite, ils ont réuni les trois percussions principales des musiques afro-cubaines (congas, timbales et bongos) et en ont codifié (limité aussi, si on veut) l’usage. Et puis il y à l’utilisation plus systématique du piano en remplacement du tres (la guitare cubaine à trois paires de cordes). Enfin, il y a l’homme de l’ombre, l’ingénieur du son, qui, à New York, a « inventé » une nouvelle façon d’enregistrer la musique afro-cubaine (bénéficiant des technologies propres
à l’industrie du disque états-unienne, que Cuba ne pouvait déjà plus se payer en 1970, en raison du blocus ; ce qui ne les a pas empêché d’utiliser avec bonheur les installations des studios EGREM, expropriées aux compagnies discographiques états-uniennes après la révolution), tout comme l’ont fait les ingénieurs du son Colombien, d’une autre façon, donnant à la salsa de leur pays une couleur particulière. Tout ces apports, on peut certes les considérer comme quantité négligeable par rapport au génie des musiciens cubains, mais on ne peut pas les nier complètement sans faire une grave injustice à l’histoire de la salsa.
En fait, ce débat sur les racines africaines de la musique cubaine (qu’on ne peut pas contester, bien évidemment) me fait un peu penser au débat dans les Antilles françaises entre les « anciens » tenants de l’africanité (comme Aimé Césaire) et les « modernes » tenants de la créolitude (comme Raphaël Confiant). Raphaël Confiant estime (à juste titre à mon « humble » avis de parisien blanc) que considérer les racines africaines de la culture caraïbes comme étant son élément principal revient à nier l’histoire moderne de cette région, et à considérer que, depuis l’arrivée des esclaves africains, rien n’a évolué, rien n’a changé, rien ne s’est mélangé. Au contraire, il défend avec ardeur cette culture qui est la sienne, la culture créole, dans laquelle il est né et a vécu, qui a depuis maintenant plusieurs siècles pris un chemin différent de la culture africaine, et qui s’est constituée comme un ensemble riche et complexe de traditions propres (littéraires, musicales, sociales, etc.), unique en son genre, qui n’a plus avec l’Afrique qu’un lien de parenté, qui est a en quelque sorte définitivement atteint sa « majorité ». La musique cubaine, finalement, c’est ça, c’est de la musique « créole ». Car « criollo » est un terme revendiqué également par de nombreux musiciens cubains, qui y tiennent certainement tout autant que d’autres au terme « afro », qui, si j’en juge par les dernières interviews que j’ai pu lire, ne constitue plus autant une revendication identitaire (comme cela a pu être le cas dans les années 70), mais plutôt une volonté d’explorer la musique africaine comme une des nombreuses composantes de l’arbre généalogique de la musique cubaine.
Et, pour conclure, je laisserai la parole au Grupo Niche, dans Etnia (mon morceau colombien préféré, autant pour la musique que pour les paroles), que je cite et traduit de mémoire (avec tous les risques d’erreurs que cela comporte, et que j’assume ici parfaitement) : « Il y a des Rodriguez blancs, il y a des Gonzalez noirs. Parce qu’il est tombé plus de lait dans leur café, ce ne sont pas des Rodriguez. »
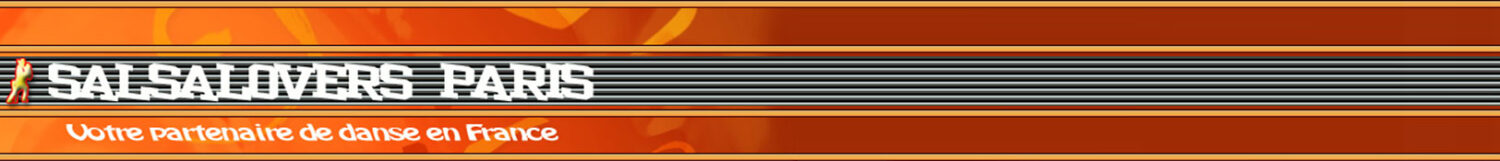







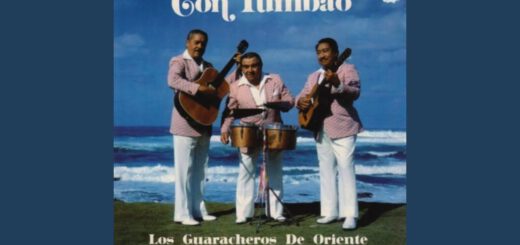











 Thomas & Lilo…
Thomas & Lilo…




